
La campagne ne rebute pas tous les jeunes médecins. Céline Madeuf remplace, pendant leurs vacances, un couple de généralistes de Brassac-les-Mines, un ancien site de production de charbon, à une heure de Clermont-Ferrand. Elle a choisi l'exercice rural parce que «la relation avec les patients est d'une qualité exceptionnelle». Dans cette région, le niveau de vie est modeste, les pathologies sont sévères, les médecins, débordés. Les remplaçants tiennent rarement plus d'un an. Le Dr Madeuf y revient, elle, pour la quatrième année de suite.
Sa première visite, ce mardi du mois de mars, est pour une veuve de 73 ans. Une vieille connaissance. Au téléphone, la dame s'est plainte de mal tolérer le nouveau médicament prescrit par son cardiologue. Les deux mains posées bien à plat sur la table de la cuisine, Mme B. prend maintenant le médecin à témoin: «Regardez, comme j'ai attrapé la tremblote, on dirait que j'ai bu du vin.»
Le Dr Madeuf demande à voir l'ordonnance de son confrère et la rassure aussitôt. «Je vais vous prescrire un autre médicament de la même famille, explique-t-elle. Il ne donne pas de tremblements.» Mme B. plante son regard dans le sien: «Tous ces spécialistes peuvent bien me dire ce qu'ils veulent, je ne les écoute pas. Je n'ai confiance qu'en mon docteur.»
Mais Mme B. se sent diminuée. Elle l'a dit à ses enfants, le répète, au bord des larmes: «J'en ai ras la casquette.» Là, le Dr Madeuf a un truc infaillible: «Vous me montreriez les dernières photos de votre petite-fille?» Pour la première fois depuis son arrivée, le visage de sa patiente s'illumine.
Jusqu'à 20 heures bien sonnées, la jeune femme sonnera chez d'anciens mineurs sous oxygène, des veuves qui n'ont pas le permis, des personnes trop handicapées par l'âge pour se déplacer. Une clientèle typique des campagnes qui se dépeuplent. Ni mercenaire ni Mère Teresa, cette célibataire n'a pas renoncé à la vie sociale de la ville. Elle a gardé son appartement à Clermont-Ferrand.
La réforme tant attendue de l'assurance- maladie les concerne au premier chef. Sont-ils trop peu nombreux ou trop mal répartis? Bien payés ou pas assez? Suffisamment préparés aux enjeux économiques et thérapeutiques de leur métier? Plongée au cour d'une profession en pleine crise existentielle.
Maud, 26 ans, ne prendra pas la relève. Les habitants du bourg de Mondoubleau, au cour du Perche, ne seront pas soignés par la quatrième génération des Drs Charreau. Pourtant, la jeune femme a bien reçu la vocation de médecin généraliste en héritage. Mais elle va s'installer à Nice, la ville de ses études et de son conjoint. «La campagne? C'est non, tranche Maud. On est seul, sans confrère pour vous épauler, et il est impossible de préserver sa vie de famille.» Ce n'est pas sa mère, le Dr Martine Charreau, qui pourra la contredire. A 55 ans, celle-ci cherche en vain la solution pour alléger ses soixante à soixante-dix heures de travail par semaine. A ce jour, personne n'a répondu à ses SOS lancés par petites annonces: cherche associé désespérément. La mairie offre pourtant le logement gracieusement pendant un an. «Et moi, je suis prête à faire un pont d'or au candidat qui se présentera en assurant toutes les gardes de nuit...», soupire-t-elle.
Son beau-père, le Dr Jacques Charreau, deuxième du nom à Mondoubleau, estime «avoir déjà eu beaucoup de chance de l'avoir trouvée, il y a six ans, pour reprendre le cabinet familial». Ce retraité de 69 ans constate que le métier est effectivement devenu de plus en plus difficile au fil des années. Le rapport avec les patients s'est compliqué et les échanges avec la Sécurité sociale sont devenus de plus en plus tendus.
Ah! les toubibs et la Sécu... Le Dr Charreau en parle un peu comme d'un couple qui aurait raté son mariage de raison. Pour cet ancien médecin de campagne, la déception est d'autant plus grande qu'il a vu naître le système de protection sociale. «Ce fut un progrès formidable, raconte-t-il. Avant, les patients appelaient souvent trop tard. Comme cet agriculteur que je n'ai pas pu sauver, parce que sa banale appendicite était déjà au stade de la péritonite.»
Cet épisode tragique remonte à ses débuts, dans les années 1960. Juste avant l'entrée - tardive - des médecins du Perche dans le système des conventions avec la Sécurité sociale: fin des tarifs libres et adoption d'un prix de consultation fixe, remboursé à 80%. La généralisation de cette organisation, en 1971, ouvre l'accès aux soins pour tous et marque le début d'un âge d'or pour les médecins libéraux. Leur nombre est d'ailleurs passé de moins de 50 000 cette année-là à 118 000 en 2001, selon la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques (Drees). Mais le système est aujourd'hui victime de son succès et de multiples abus. Résultat: l'assurance-maladie s'enfonce dans le rouge. Son déficit pourrait atteindre cette année le record de 12,9 milliards d'euros. Le nouveau ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, n'a pas d'autre choix que de réformer. Et de fixer, avec les médecins, de nouvelles règles du jeu. Car, au-delà des questions d'argent, la pénurie de praticiens dans les campagnes justifie à elle seule une véritable réorganisation. Faudra-t-il revenir sur la liberté d'installation du médecin? Limiter celle du patient de consulter qui il veut, quand il veut? Ou encore contrôler le contenu des ordonnances?
Etre un jour affecté d'autorité dans un bled en manque de toubibs: c'est la hantise de l'étudiant en médecine dans toutes les facultés de France. La liberté de poser sa plaque où bon lui semble pourrait bien être remise en question. Car l'égalité d'accès aux soins, véritable pilier de la santé publique, est aujourd'hui en danger. Les praticiens libéraux sont très inégalement répartis sur le territoire. Leur densité varie de 1 à 4 entre le département le plus faiblement doté, la Mayenne, et le mieux doté, Paris, avec respectivement 205 et 834 professionnels pour 100 000 habitants. Certes, le nombre de diplômés va augmenter d'ici une dizaine d'années, puisque Philippe Douste-Blazy prévoit d'augmenter le nombre de places en deuxième année de médecine. Le numerus clausus, instauré en 1971, va ainsi être progressivement porté de 5 700 à 7 000. Mais pourquoi diable ce contingent supplémentaire de médecins s'installerait-il au vert? La tendance n'a aucune raison de s'inverser si rien n'est fait pour remédier aux causes réelles de la désertion des campagnes. Ces mêmes raisons sont à l'origine de la crise existentielle que traverse actuellement la profession.
Le médecin n'est plus ce pilier de l'organisation sociale qu'il était au début du siècle, aux côtés du prêtre, du maire et de l'instituteur. Il exerce un art en constante évolution, dans lequel l'explosion des connaissances a multiplié les spécialisations. Et les patients, qui ont désormais leurs propres sources d'informations, ne lui accordent plus le savoir absolu. Dans ces circonstances, on comprend bien les réticences des jeunes diplômés, frais émoulus de l'hôpital, où toutes les compétences sont réunies, à l'idée de se retrouver seuls en pleine cambrousse. Pourtant, en choisissant de préférence les grandes villes, ils aggravent l'isolement et la charge pesant sur leurs confrères qui exercent ailleurs, créant de ce fait un véritable cercle vicieux.
Un rythme soutenu de plus en plus mal vécu
Ainsi, dans le Puy-de-Dôme, Céline Madeuf, 32 ans, a préféré ne pas reprendre de cabinet. Elle a choisi de rester remplaçante pour garder du temps libre. L'an dernier, cette célibataire a travaillé entre deux et trois semaines par mois, pour un revenu net annuel de 33 000 euros (lire l'encadré ci-dessus). En effet, les médecins se sentent de moins en moins en phase avec une société qui apprécie les 35 heures. Les généralistes libéraux, par exemple, alignent en moyenne cinquante-six heures de travail hebdomadaires. Ce rythme soutenu est de plus en plus mal vécu par une profession qui ne cesse de se féminiser (37% de femmes en 2002). Sans compter la contrainte des astreintes de nuit et de week-end. Les médecins sont en effet tenus d'assurer dans leur secteur la «permanence des soins», une obligation légale. Pour organiser ces tours de garde tout en préservant leur vie personnelle, certains ont fait preuve d'une grande créativité. En trois ans, 80 maisons médicales de garde ont ainsi été créées avec l'aide de financements publics. Avec, chacune, ses propres règles de fonctionnement.
A Montélimar, dans la Drôme, le patient qui appelle le médecin de garde a ainsi la surprise de le trouver non pas chez lui, mais à l'hôpital! Les 35 généralistes de Montélimar ont en effet passé un accord original avec le service public, qui rend les astreintes beaucoup moins pénibles. Le principe? Un simple échange de bons procédés. De 20 heures à minuit, le généraliste de permanence reçoit ses appels et ses patients au service des urgences, dans un bureau qui lui est réservé. Et il examine aussi toutes les personnes qui se présentent à l'accueil pour un problème bénin. L'équipe hospitalière est ainsi déchargée de la «bobologie». Après minuit, c'est l'inverse. Le médecin de ville rentre dormir sur ses deux oreilles, après avoir transféré sa ligne sur le poste des urgences. Et les internes réceptionnent ses appels jusqu'au matin. Au bout de quatre mois de rodage, le système est maintenant bien huilé. Pour ces médecins de ville, le fait de franchir la porte de l'hôpital constituait pourtant, en soi, une révolution.
Quand le généraliste de garde arrive dans le service, en ce jeudi du mois de mars, il se fait tout petit, silhouette incongrue en jean et polo au milieu des blouses blanches. Le Dr Pascal Vallé pose un instant sa grosse serviette de cuir, le temps de serrer les mains. Puis il file vers son antre, situé un peu à l'écart des urgences. A l'origine, ce médecin de 44 ans faisait partie des opposants au changement. «Les urgences attirent une autre clientèle que la nôtre, qui vient dans l'idée de ne pas payer les soins», estime-t-il. Un autre monde? Il y trouve en tout cas son compte. Ce soir-là, une lycéenne, puis un bébé, lui seront envoyés par l'infirmière d'accueil. Deux patients qui ont appelé le numéro du médecin de garde viendront aussi le consulter sur place. Sa seule visite sera pour une dame âgée, qui ne possède pas de voiture. En quatre heures, le Dr Vallé a gagné très exactement 278,50 euros. L'essentiel, pour lui, est d'être correctement payé de sa peine. Pour d'autres de ses confrères, c'est d'abord la bonne nuit de sommeil qui compte. Ailleurs en France, ils sont encore nombreux à se faire réveiller par le téléphone. Le problème est particulièrement aigu dans les zones rurales, où les jours de permanence sont répartis sur trop peu de personnes. Comme dans le Gard, où les généralistes ont décrété le 1er avril dernier la grève des
gardes.
|
Les étudiants en
médecine
en nombre par an
|
Les médecins:
leurs revenus...
honoraires totaux des médecins libéraux*,
base 100 en 1980
|
... et leur nombre**
|
|
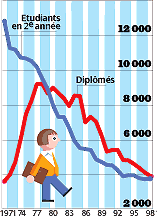
|
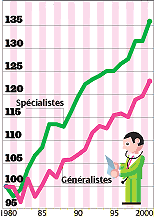
|
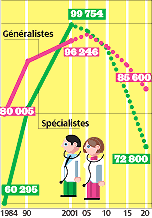
|
|
Source : Dress
|
* Corrigés de
l'inflation et de la démographie médicale
Source : Source : Cnam, 2002
|
** Médecins
hospitaliers compris
Source : Dress
|
Contestation et convention
Parmi les protestataires, les plus remontés ont choisi de passer en force en augmentant d'office le prix de leurs consultations. Le Dr Eric Rouxel, à Buxerolles, près de Poitiers, a ainsi fait grimper d'autorité le prix de sa consultation de 25 à 40 euros! Ce spécialiste des yeux est devenu, sans l'avoir voulu, l'une des figures emblématiques de la contestation. Car il compte parmi les rares médecins à avoir été sanctionné par la caisse primaire d'assurance-maladie de son département. Sa punition? Le trublion a été «déconventionné», c'est-à-dire que ses patients ne sont plus remboursés du tout par la Sécu. Le but recherché était de lui couper les vivres en vidant sa salle d'attente. Mais la caisse avait oublié un détail... Le Dr Rouxel exerce dans une des nombreuses régions où les ophtalmologues ne sont pas assez nombreux pour faire face à la demande. Résultat: sa clientèle est toujours aussi fournie, et c'est elle qui est pénalisée.
|
La densité de médecins
(les spécialistes)
nombre de médecins pour 100 000 habitants
en 2000 par département
|
La densité de médecins
(les généralistes)
nombre de médecins pour 100 000 habitants
en 2000 par département
|
|
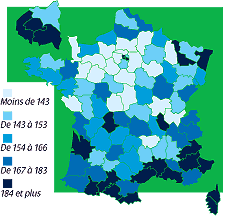
|
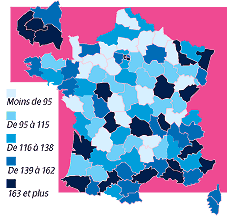
|
|
Source : ordre des médecins, Credes
|
Source : ordre
des médecins, Credes
|
Des médecins prennent donc délibérément leurs patients en otages. Plus personne ne s'étonne de voir des cheminots bloquer les usagers, mais le même comportement, venant du corps des soignants, surprend. La crise, en fait, était rampante. Au fil des années, l'écart de revenus entre les deux catégories de spécialistes s'est creusé. Aujourd'hui, un ophtalmologue de secteur 1 gagne en moyenne 81 554 euros net par an, selon la caisse de retraite des médecins libéraux (la Carmf). Le même spécialiste exerçant, lui, en secteur 2 touche 38 295 euros de plus... Soit un bonus supérieur à 40%! La différence atteint même le record de 87% chez les pédopsychiatres.
Les malgré-nous du secteur 1 comptent aussi des légitimistes, demandant aux tribunaux que justice leur soit rendue. Ainsi, 2 300 spécialistes ont assigné les caisses primaires d'assurance-maladie pour obtenir le droit de passer en honoraires libres. La plupart se sont regroupés dans l'Association pour l'ouverture du secteur 2 (Apos 2). A ce jour, 17 décisions ont été rendues en leur faveur et 15 en leur défaveur. Mais il faudra attendre les premiers procès en appel pour savoir de quel côté va vraiment pencher la balance.
|
Les dépenses qui
dérapent
hausse en % des dépenses en volume
|
La consommation
des médicaments
en dollars, par pays, en 2001
|
|

|
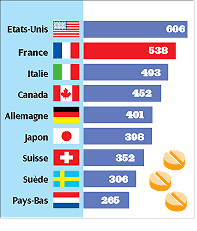
|
|
Source : OCDE
|
Source : Drees
|
De Dr Jean Leid, cofondateur d'Apos 2, veut croire que la voie légale est la bonne. Cet activiste était, au départ, un spécialiste tout à fait dans le rang. Lors de son installation à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en 1982, cet ophtalmologue opte sans états d'âme pour le tarif conventionnel. Il n'a d'ailleurs pas vraiment le choix. Les habitants ne sont pas prêts à payer un supplément au médecin. La norme, dans cette région où beaucoup de familles ont travaillé au gisement de gaz de Lacq, c'est le statut de mineur et son remboursement à 100%. Au début des années 1990, le Dr Leid a «commencé à rallonger ses horaires pour compenser l'augmentation de [ses] charges». Aujourd'hui, il annonce travailler soixante-quinze heures par semaine, contre cinquante à ses débuts. Avec un salaire horaire qui aurait été divisé par deux. Mais le plus insupportable n'est peut-être pas là. A Pau, les mentalités ont changé. La ville compte maintenant deux ophtalmologues installés en secteur 2, en plus des 14 exerçant au tarif conventionnel. Et la demande est telle que ces deux-là n'ont aucune difficulté à remplir leur carnet de rendez-vous...
Les spécialistes du secteur 1 ne peuvent pas pour autant crier misère. Ils gagnent en moyenne 78 845 euros net, soit deux fois plus qu'un cadre des secteurs privé et semi-public, selon l'Insee. Et, dans leur ensemble, les médecins ont connu ces vingt dernières années une progression de leur pouvoir d'achat nettement supérieure à celle des autres actifs, salariés ou libéraux. «Contrairement à ce qu'ils affirment souvent, les professionnels de santé ne sont pas les oubliés de la croissance», tranche Jean de Kervasdoué, professeur en économie et gestion des services de santé au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).
Mais ce phénomène ne doit pas occulter la grande diversité qui caractérise la médecine libérale. Selon les spécialités, le revenu net moyen varie en effet du simple au quadruple! Personne n'a jamais entendu un spécialiste de médecine nucléaire se plaindre. Et pour cause. Ces experts du traitement des cancers par rayons sont les mieux rémunérés: 157 247 euros en moyenne par an. Les doléances viennent de ceux qui sont au bas de l'échelle, les endocrinologues (44 557 euros), par exemple, ou encore les pédiatres (58 531 euros), qui ont un revenu inférieur à celui des généralistes (60 907 euros)... Les mécontents sont, en somme, tous ceux qui ont besoin de temps pour bien soigner et qui ne peuvent pas compléter le prix de la consultation avec des actes techniques rémunérés en sus.
Du côté des spécialistes, les revendications portent moins sur la qualité de leur sommeil que sur leurs finances. Partout en France, des ophtalmologues, des gynécologues ou encore des endocrinologues réclament la liberté du prix de leur consultation. Car, aujourd'hui, ces médecins trouvent injuste d'être bloqués au tarif de base, celui qui permet aux patients d'être remboursés au mieux. Ces praticiens, dits de secteur 1, veulent bénéficier des mêmes conditions que leurs confrères exerçant en secteur 2. Ces derniers, qui représentent aujourd'hui un tiers des spécialistes, sont autorisés à fixer des tarifs plus élevés. Le surcoût est à la charge du patient ou, éventuellement, de sa mutuelle. L'origine de ce deuxième statut? A quelques mois de la présidentielle de 1981, le gouvernement de droite avait fait ce cadeau aux médecins dans l'idée de satisfaire leurs demandes d'augmentation sans pour autant ruiner la Sécu. Mais, dix ans plus tard, la gauche au pouvoir décidait la quasi-fermeture du secteur 2, jugeant ce système à deux vitesses injuste pour les malades. Aujourd'hui, ce statut n'est plus accessible qu'à un petit nombre de jeunes diplômés au parcours hospitalo-universitaire particulièrement brillant.
Soigner. Les difficultés propres à cette mission sont trop souvent oubliées par ceux qui résument les soucis de la profession à des questions d'argent. «Les médecins ont l'impression d'être mal aimés, accusés de maux dont ils ne sont pas responsables», résume le Dr Hélène Chapoulart. Cette gynécologue de Bordeaux est bien placée pour constater la crispation. Elle quitte régulièrement son cabinet pour mettre en place, au sein de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes), la toute première évaluation de la qualité des soins en ville. La phase expérimentale s'achève, mais les volontaires restent rares. Pourtant, les candidats sont simplement invités à pratiquer un autoexamen, avec l'aide d'un pair, concernant des aspects de leurs pratiques qui pourraient être améliorés. Par exemple? Vérifier les rappels de la vaccination contre le tétanos chez les adultes ou, mieux, veiller aux mélanges de médicaments incompatibles chez les personnes âgées. La démarche est logique, mais arrive en terrain miné. Les médecins y voient d'abord une nouvelle source de remises en question. «Tout le monde croit qu'il y aura des sanctions à la clef, alors que ce n'est absolument pas le cas!» regrette le Dr
Chapoulart.
«Le risque judiciaire nous hante»
Climat tendu ou non, le seul fait de s'interroger sur leurs compétences constitue de toute façon une révolution culturelle pour les toubibs en place. «Nous avons été mal élevés», reconnaît ainsi le Dr Roland Crestel, médecin généraliste à Dechy, dans le Nord, formé dans les années 1970, époque des promotions records des baby-boomers. «A la faculté de médecine, nous avons été éduqués dans l'idée que nous savions tout, poursuit-il. En plus, personne ne nous a parlé de notre part de responsabilité dans la limitation des dépenses, donc dans la préservation du système.» La jeune génération, elle, a été mieux informée. Pour Maud, l'héritière de la lignée des Drs Charreau du Perche, faire attention au coût de son ordonnance va de soi: «J'ai le réflexe de regarder dans le livret de la Sécu s'il existe un générique correspondant au traitement que j'ai retenu.» Pour sa mère, le geste est nettement moins naturel. «J.e n'ai pas le temps de tout réapprendre, plaide le Dr Martine Charreau. Et pourquoi nous pénaliser quand on prescrit trop peu de génériques, puisque le pharmacien a le droit de faire le remplacement?» Elle est lasse de s'entendre reprocher de creuser le trou de la Sécu, d'autant qu'elle a plutôt le sentiment de se battre pour éviter les dérives. «Il faut de plus en plus résister aux malades J'y-ai-droit», constate-t-elle. Droit à l'ambulance. A l'infirmier à domicile. Aux séances de kinésithérapie. A la liste de médicaments préparée à l'avance...
Il y a les exigences des patients au quotidien. Et, plus sournoise, la crainte du procès. Les mises en cause de professionnels de santé devant la justice sont encore rares, mais très médiatisées. Ces cas sont montés en épingle par les assureurs pour justifier l'augmentation des primes de certaines spécialités, comme la chirurgie. D'où une hypersensibilité des médecins sur le sujet. «Le risque judiciaire hante toutes nos années d'études, reprend Maud. Je ne peux plus pratiquer la même médecine que ma mère, fondée sur une grande confiance en son propre sens du diagnostic. Devant un tribunal, seule une radiographie peut servir d'argument!» Entre le médecin et son patient, la défiance pointe et pourrait bien s'installer. Si la réforme ne veut pas seulement être comptable, elle doit réussir à réconcilier durablement ces deux partenaires du système de santé.
Post-scriptum
Les syndicats de médecins sont en première ligne pour négocier avec le ministre de la Santé la réforme de l'assurance-maladie. Sont représentatifs la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF, 12 000 adhérents), le Syndicat des médecins libéraux (SML, 8 200 adhérents), Médecins généralistes de France (MG France, 8 840 adhérents) et la Fédération des médecins français (FMF, 7 000 adhérents).



