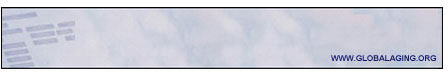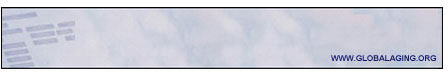Par Martin
Vial, Le Monde
France
29 novembre
2006
L'allongement de l'espérance de vie est un progrès
formidable, mais aussi un vrai défi économique et sociétal en Europe de
l'Ouest. A l'horizon 2010, près du quart de la population de la région
aura plus de 60 ans, et 20 millions de personnes seront "dépendantes" ou
en situation de perte d'autonomie, nécessitant des soins de longue durée.
Le besoin de financement associé est considérable : le coût de la prise
en charge par la Sécurité sociale d'une personne âgée de plus de 65 ans
est 2,6 fois plus élevé que celui de la moyenne de la population, et 4,5
fois pour une personne âgée de plus de 80 ans.
Face à ce formidable défi pour nos sociétés de ce début de siècle, c'est
une réflexion globale qui doit être menée, en intégrant bien sûr la
prise en charge en établissement spécialisé, mais surtout le maintien à
domicile sous assistance. D'une part, parce que, en 2010, 8 millions de
personnes âgées seront non autonomes, mais non hospitalisées, et d'autre
part parce qu'en amont de l'hospitalisation, ou après, les systèmes de
maintien à domicile permettent de ralentir nettement la perte
d'autonomie ou son aggravation, en sauvegardant le lien social et le
cadre de vie des personnes âgées. Pour une question de coûts, aussi : en
France, la prise en charge hospitalière d'une personne âgée dépendante
est 1,5 à 2 fois plus coûteuse qu'à domicile.
La transformation des comportements liée à l'urbanisation, en
particulier l'affaiblissement de la solidarité familiale ou de voisinage
qui prévalait dans les sociétés rurales, accentue encore les besoins de
prise en charge. La demande de services recouvre l'assistance médicale,
le transport de repas et de médicaments, les aides ménagères, la mise en
relation avec différents organismes. En amont, le besoin augmente pour
des prestations accompagnant la perte d'autonomie (bilan de santé,
intervention d'un ergothérapeute - qui aide les patients présentant un
déficit fonctionnel à s'adapter à leur handicap -, transport vers une
maison spécialisée, télé-assistance...). On estime que le volume global
des services à domicile et à la famille devrait croître de plus de 10 %
par an en moyenne d'ici à 2010 en France.
Se pose alors la question de la répartition du financement et des forces
à mettre en oeuvre, à un moment où l'opinion publique est de plus en
plus en demande de garantie et d'assistance. Le financement de la
dépendance doit relever d'un double principe, solidarité et
responsabilité personnelle.
Tout d'abord le consensus français porte sur la mutualisation et la
solidarité nationale. A cet égard parce que la gestion du "risque
dépendance" diffère de celle du risque santé par le caractère permanent
de la couverture de ceux qui sont entrés en dépendance, du fait de son
fort niveau de probabilité pour les mêmes tranches d'âge et parce que le
besoin de services liés à la dépendance dépasse celui des seuls soins
médicaux, la création d'un régime spécifique - une cinquième branche -
paraît s'imposer.
Mais parce que les besoins de financement à moyen terme sont
considérables, il faut également aller vers plus de responsabilisation
personnelle. En 2004 en France, un peu plus de 1,8 million de personnes
étaient assurées pour le risque de dépendance, et ce nombre progresse
d'environ 200 000 personnes par an depuis 2000. La question qui se
posera dans les prochaines années est celle de la couverture de ce
besoin de financement et, compte tenu de son impact considérable sur les
prélèvements obligatoires, d'un système d'assurance obligatoire à
l'instar de ce qui existe déjà dans certains pays.
Au-delà de la question du financement, la prise en charge de la
dépendance doit être considérée comme un secteur d'activité spécifique.
Les emplois générés par ce secteur, la diversité des intervenants et la
croissance de la demande en font un des grands secteurs économiques et
sociaux du domaine des services. Aujourd'hui, la fourniture des services
à la personne en France est essentiellement assurée par des acteurs
associatifs et par les sociétés d'assistance, qui ont développé au fil
des années un savoir-faire précieux. Dans le futur, cette expertise
permettra de concevoir des gammes de services et de soins intégrés,
d'évaluer les besoins en ressources humaines, en capacités d'accueil,
d'optimiser les coûts de santé, et de gérer des réseaux complexes, avec
des labels d'engagement et de qualité.
Ensuite, la dépendance sera traitée de la façon la plus adaptée au
niveau local, comme c'est le cas dans les pays scandinaves. En France,
la demande des collectivités locales pour des structures de proximité
est importante. C'est la raison pour laquelle certaines entreprises
d'assistance de dimension mondiale - qui ont donc une vision et une
expérience de ce qui se fait à l'étranger - développent déjà, en
partenariat avec les collectivités locales, des projets de plates-formes
médico-sociales sur notre territoire. Ces plates-formes feront office de
"centres médico-sociaux à distance", qui regrouperont des ressources sur
un centre d'appel, notamment des médecins et assistants sociaux
spécialement formés, afin d'identifier les publics, de dresser des
diagnostics de dépendance, de définir les besoins et de rechercher des
financements.
La dépendance est l'un des grands enjeux collectifs des prochaines
années en Europe de l'Ouest. Un effort massif en faveur du maintien à
domicile doit être entrepris visant à ré-autonomiser les personnes
fragilisées grâce à une convergence globale, au niveau national et
local, des initiatives des acteurs publics et privés. Cette convergence
se traduira par un nouveau "contrat social" sur la fin de vie, offrant
des garanties et des services mieux ciblés en fonction des besoins réels
et permettant une meilleure maîtrise des coûts et des dépenses.
Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use |
Privacy Policy | Contact
Us