
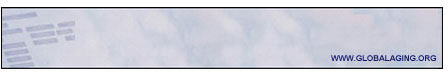
 |
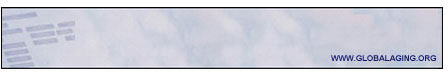 |
|
|
|
||
| SEARCH | SUBSCRIBE | ||
|
France
«Mamita»
avait fait jurer à Jeanne, sa fille, qu'elle s'assoupirait dans son petit
lit, chez elle, «pas à l'hôpital, pas dans une maison de retraite». Sa
vie chétive, depuis des mois, s'était rétrécie à sa chambre. Sa tête
se perdait. Le jour de l'An, Mamita a fait une crise de lombalgie.
Direction les urgences. Ça bouchonne. Mamita crie. Jeanne entend une
infirmière, débordée: «C'est pas une urgence, la vieille, 85 ans et démente.»
Mamita va rester là six heures, poids mort sur un brancard. Elle est
admise en médecine interne. Elle panique. On l'attache. «Trois jours après,
elle avait totalement changé, murmure Jeanne. Un matin, je l'ai retrouvée
nue, déshydratée, sur son lit, en attendant ses couches. Un agent, pas
formé, lui enfournait sa compote dans le dentier en dix minutes.» Peu
après, aux soins intensifs, Mamita s'est endormie pour toujours, un tube
dans le nez, une blouse d'hôpital pour linceul. Jeanne est arrivée trop
tard, «d'une demi-heure». Elle n'a pas tenu sa promesse à Mamita. Elle
hurle de rage et de honte: «On l'a tuée d'indifférence.» On
tue les vieux (Fayard): c'est le titre d'un livre-enquête qui sort ces
jours-ci. Un réquisitoire délibérément provocateur qui cogne direct
dans le plexus, histoire d'alerter les consciences sur «la maltraitance,
insidieuse, addition de petits dysfonctionnements institutionnels, qui tue
plus que la canicule», comme l'affirme le Pr Jacques Soubeyrand, coauteur
et chef du service de médecine interne et gériatrie à l'hôpital
Sainte-Marguerite de Marseille. «Il ne s'agit surtout pas de jeter
l'opprobre sur les établissements, mais de dénoncer certaines dérives
et un système tout économique, où la vieillesse n'est plus vue qu'en
termes d'inutilité, de contraintes. A partir du moment où on ne donne
pas à ces personnes tous les soins qu'elles mériteraient, on accélère
leur fin.» Une «euthanasie économique et sociale», donc. Qui
commencerait dès l'hôpital. Déjà,
plus le patient est vieux, plus il attend aux urgences. «Là où, pour un
jeune de 20 ans, cardiaque, on va trouver un lit, il faut passer 50 coups
de fil pour quelqu'un de 80 ans», résume le Dr Christophe Trivalle, gériatre
à Paul-Brousse (Villejuif). Les services tournent à flux tendus et,
faute d'unités de court séjour gériatrique dans de nombreux hôpitaux,
les urgences manquent de solutions pour les anciens. Bien obligé, parfois,
de les transférer où l'on peut, «c'est-à-dire n'importe où»,
souligne le Pr Alec Bizien, chef du service de médecine interne gériatrique
de Georges-Clemenceau à Champcueil (Essonne), qui voit «trop souvent»
arriver des patients du service de dermato... pour un problème au cœur,
après quatre jours aux urgences. Selon une étude de 2003, 23% des
personnes âgées étaient touchées par ces «mauvaises orientations». Services
non adaptés, défaut de personnel et de formation gériatrique... «C'est
aussi comme ça qu'on crée la dépendance, affirme le Dr Patricia
Fourmann-Geoffroy, chef d'un service de long séjour à Sarrebourg. Au
lieu d'emmener ces patients aux toilettes, on les laisse au lit, on leur
met des couches... Et ils deviennent grabataires.» Pour ceux dont l'état
nécessite une admission dans un service de spécialité, d'autres problèmes
se posent: «Si le patient est un peu dément, on nous dit: "Pas de
place'', souligne le Dr Trivalle. Le service sait qu'il devra le garder
plus longtemps et aura du mal, ensuite, à lui trouver une place en moyen
séjour.» Le syndrome des «bloqueurs de lits»: «Un terme qu'on entend
souvent», soupire le Pr Soubeyrand. Parfois,
la logique est poussée à son comble: «Parce que la situation devient
intenable et pour libérer un lit, des soignants accélèrent la fin de
vie, et celle notamment des personnes âgées, par des surcharges médicamenteuses.
C'est un secret de Polichinelle», affirme le Dr Jean-Marie Gomas,
responsable du centre de la douleur chronique et du centre de soins
palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne, à Paris. Il l'a dit devant la
commission Leonetti sur la fin de vie. «Mais, depuis la loi, précise-t-il,
cela s'améliore.» Sans
cesse, l'éthique doit composer avec le système et ses règles économiques.
Il y a cinq ans, il arrivait au Pr Bizien de proposer des lits à des
confrères. Aujourd'hui, il ne prend plus que 1 patient sur 10. «Le vieux
en vrac chez lui, je le laisse tomber car le lit a été attribué dix
minutes avant.» Depuis
2004, la réforme de rémunération des hôpitaux - la tarification à
l'activité (T2A) - accentue encore la pression. A chaque malade et sa
pathologie, un forfait alloué. Or les anciens, souvent polypathologiques,
ont du mal à rester dans ces clous. Trop coûteux. «Chez nous, on les
garde aussi longtemps qu'avant, témoigne le Dr Trivalle. Mais on se fait
taper sur les doigts: "Votre durée moyenne de séjour est dix fois
plus longue que dans les autres services."» Rose-Marie
Van Lerberghe, ancienne directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux
de Paris (AP-HP), l'admet: «Si l'on n'y prend garde, la T2A peut avoir
pour effet pervers de sélectionner les patients.» L'AP-HP a donc élaboré
un tableau de bord pour s'assurer que l'hôpital n'exclue pas les patients
âgés. «C'est vrai, plus généralement, poursuit-elle, que le système
leur fait violence et ce n'est pas la volonté des personnels. Vrai que
les structures intermédiaires manquent, que les lits de long séjour
ferment et qu'un plan s'imposait» (voir l'encadré). Vrai,
aussi, que d'autres médecins mettent l'accent, à rebours des auteurs du
livre, sur l'hypermédication et l'acharnement thérapeutique que
subissent nombre de patients âgés. Trop ou trop peu. C'est la réponse
incertaine d'une société vieillissante confrontée à la perspective de
son propre «naufrage».
|